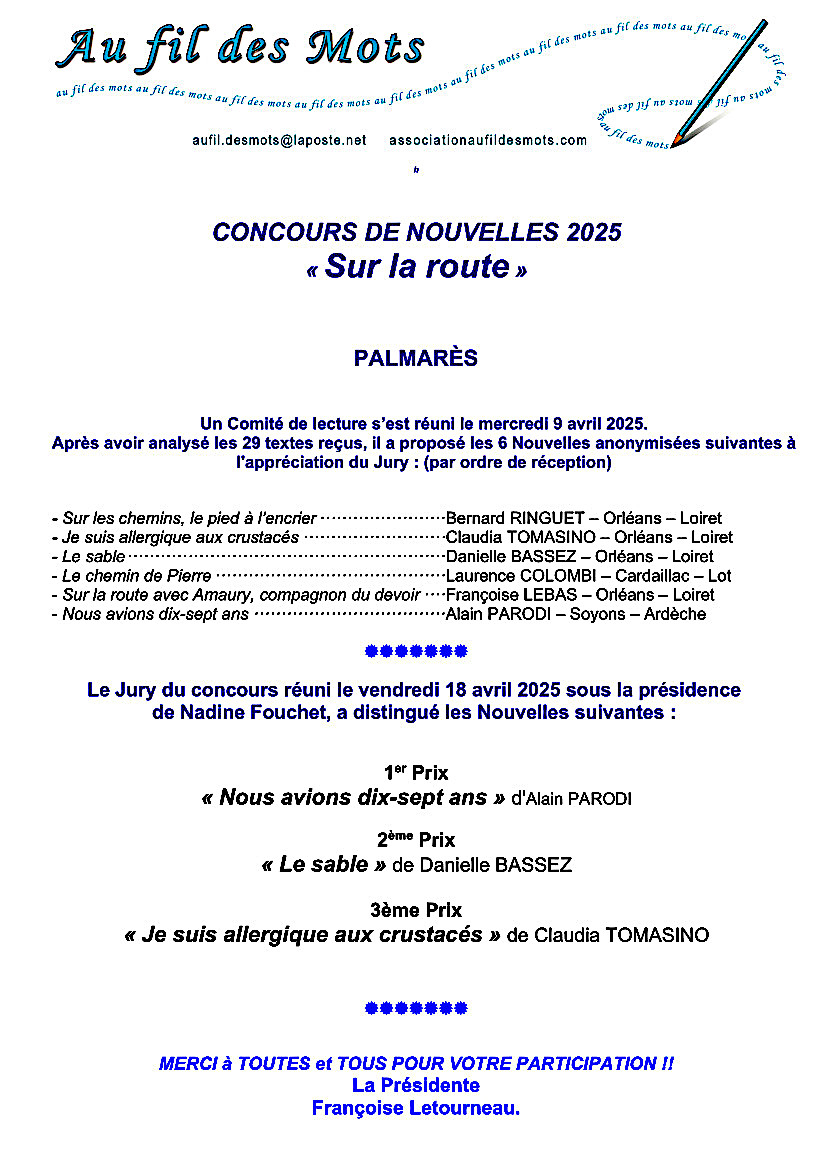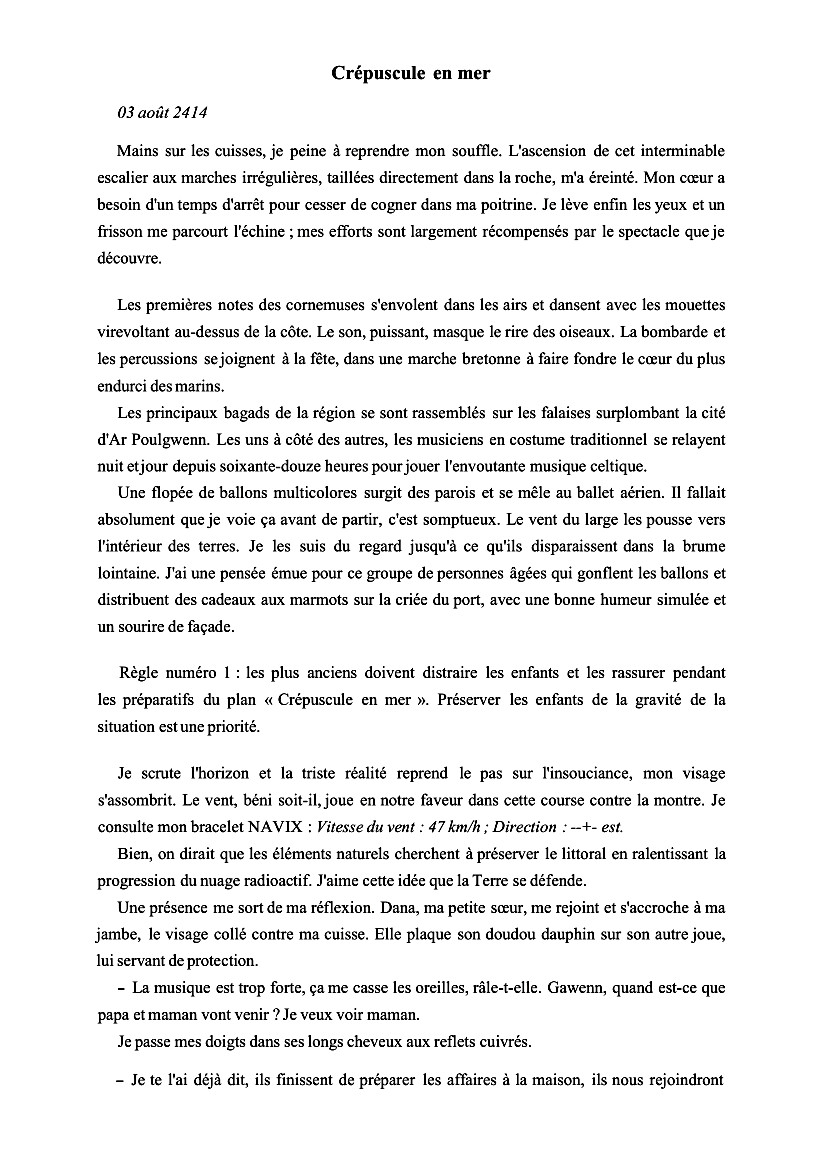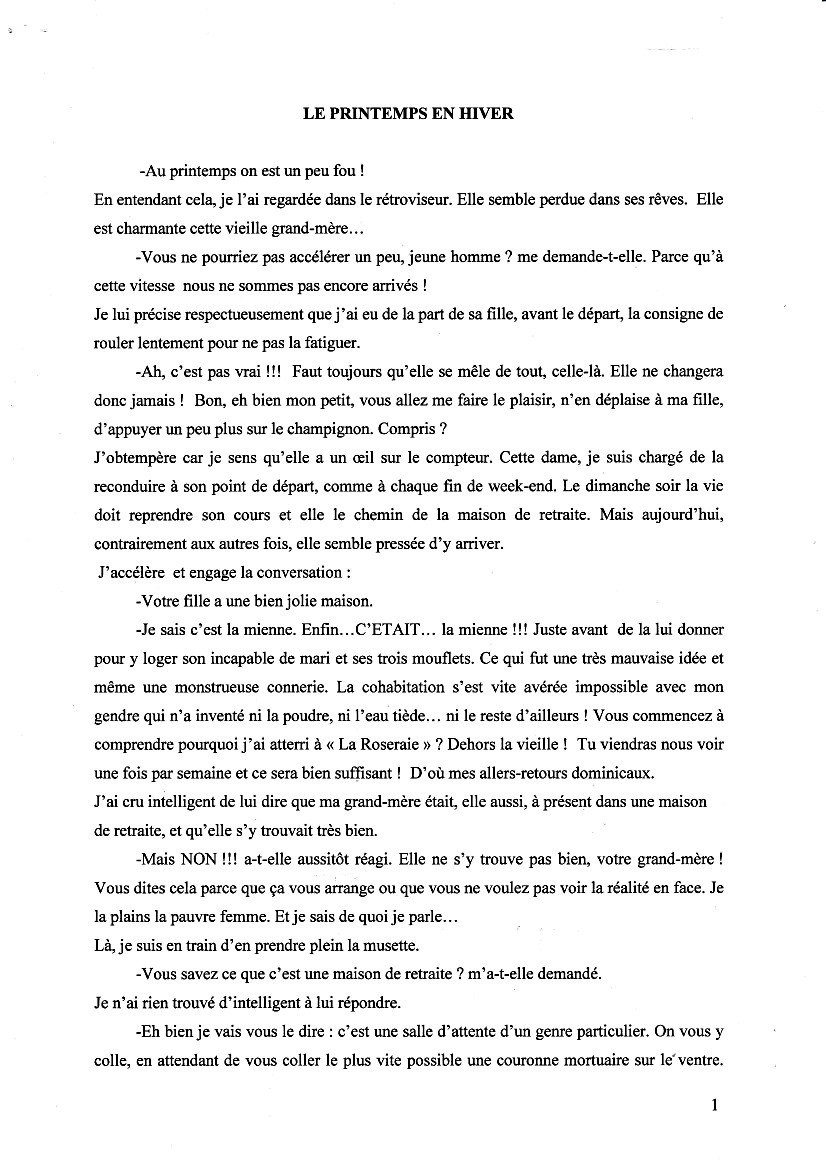Concours de Nouvelles 2024
Concours de Nouvelles 2022
Concours de Nouvelles 2021
Le Jury du concours réuni le Samedi 22 MAI sous la présidence de Roger WALLET,
écrivain, a distingué les Nouvelles suivantes :
1er Prix
« Le printemps en hiver »
de Bernard MARSIGNY (Marcoux – Loire)
2ème Prix
« Ne m’abandonne pas la nuit »
d’Emmanuelle GOSSE (Montpellier – Hérault)
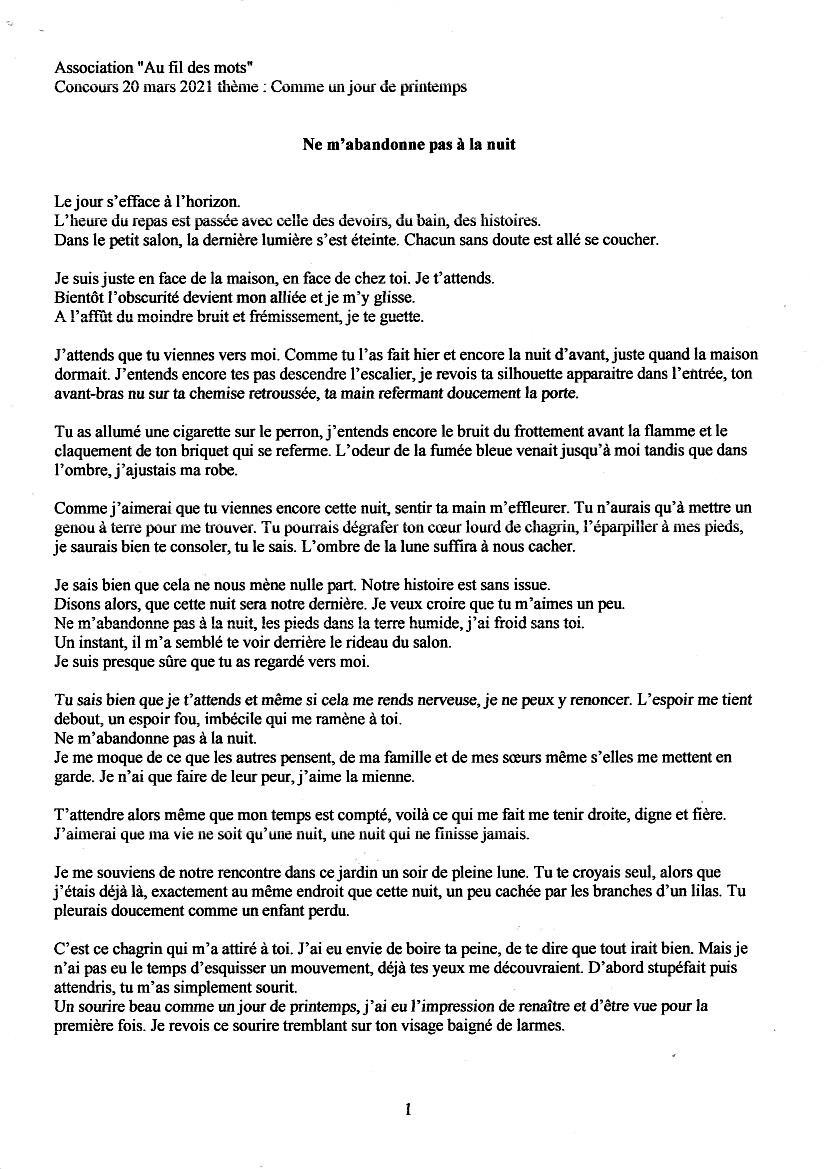 La suite de cette nouvelle vous attend dans le recueil qui sera vendu au profit du Telethon 2021
La suite de cette nouvelle vous attend dans le recueil qui sera vendu au profit du Telethon 2021